Avec son ouvrage manifeste Pour elles toutes. Femmes contre la prison, Gwenola Ricordeau écrit une page essentielle de la pensée féministe abolitionniste et jette les bases d’une réflexion prolifique sur la justice transformative. Rencontre avec celle qui se proclame haut et fort « féministe tant qu’il le faudra et abolitionniste tant qu’il y aura des prisons ».
Alors que 69% des Français·es estiment aujourd’hui que le bilan sécuritaire du gouvernement Macron est « insuffisant », et que 47% de nos compatriotes seraient favorables à la réinstauration de la peine de mort, que les violences policières sont devenues la règle dans ce pays, que les magistrat·es expriment leur détresse face à une justice défaillante, la question de la santé de notre état de droit et de notre système carcéral paraît plus que jamais brûlante. Dans ce brouhaha électoral où la justice est interprétée à tort et à travers, il est bon de relire l’un des textes les plus saisissants produits par le féminisme français ces dernières années : Pour elles toutes. Femmes contre la prison de Gwenola Ricordeau. Véritable plaidoyer féministe pour l’abolition du système pénal, ce livre paru en 2019 est une référence en matière de pensée abolitionniste et de réflexion autour de la justice transformative.
Gwenola Ricordeau est sociologue et professeure associée en justice criminelle à la California State University, Chico. À travers ses ouvrages, elle s’intéresse d’abord à la condition des proches des personnes incarcérées, au genre et à la sexualité en prison. Puis, dans ses travaux plus récents, elle affirme son militantisme pour l’abolition des prisons et la sortie du système pénal. Nous avons discuté avec elle de l’épineuse thématique de la justice autonome, des moyens de la justice transformative et de la sortie du « populisme pénal ».
Car si la France bascule vers une politique sécuritaire des plus obscurantistes, ces dernières années, les communautés LGBTQ+ se sont penchées de plus en plus sur les moyens d’affirmer une justice autonome. Des collectifs se sont formés dans plusieurs villes de France afin de réfléchir à ces questions. Des pratiques telles que la médiation, le cercle de parole et l’encadrement des conflits se répandent. Les écrits de la sociologue sont couramment cités et pris en exemple dans l’effervescence de ces discussions collectives. L’un des points de départ de cet intérêt renouvelé est le constat d’un monde queer parfois dans l’impasse face aux violences et aux conflits, en quête de manières réparatrices de faire survivre les communautés et mener à bien ses luttes. Discuter avec Gwenola Ricordeau a été l’occasion de remettre les points sur les i quant à la nécessité d’abandonner le système pénal étatique et de réfléchir ensemble à la visée politique de la justice transformative, intra et extra communautaire.
L’abolitionnisme ne se désintéresse pas des torts commis. Il dit simplement que la prise en charge par la criminalisation de certaines personnes n’est pas une bonne solution car elle ne met pas fin au système qui crée ces torts.
Gwenola Ricordeau
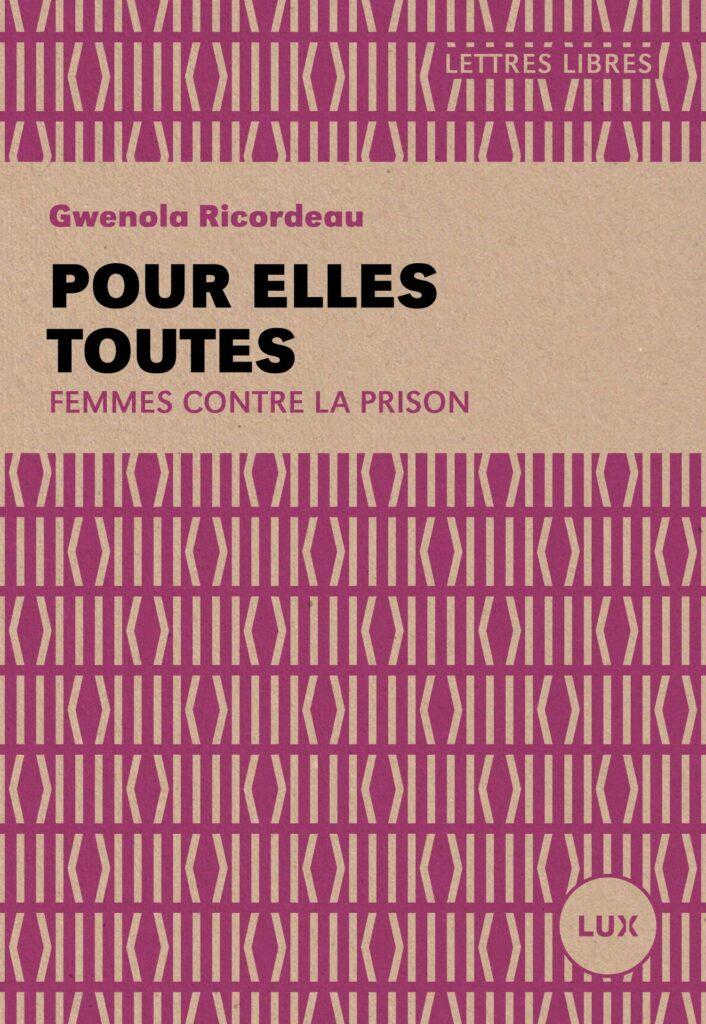
Gwenola Ricordeau : C’est sûr que nous sommes dans une période réactionnaire. Mais, en tant que militante politique, la motivation ou le découragement ne sont pas le résultat d’une période. Il y a pour moi un élan qui va bien au-delà de ce qui serait le vent du moment et d’une opportunité politique. Je me définis comme abolitionniste depuis le début des années 2000. Il y a pour moi des aspirations qui dépassent les vicissitudes de l’actualité. Je partage votre réflexion sur l’époque. Mais ce n’est pas à cela que j’accorde de l’importance, mais plutôt à la force du camp révolutionnaire et aux luttes qui sont menées. Lorsque je regarde la question de la prison, de la police, du système carcéral, je vois malgré tout qu’en France il y a des avancées en termes d’abolitionnisme. Ces cinq dernières années, beaucoup de choses se sont pensées et organisées en France qui signalent un changement, un approfondissement collectif de la critique du système pénal.
Si je peux avoir des formes de découragement, ce n’est pas tant dans le constat de l’époque réactionnaire que nous vivons mais plutôt dans certains manquements au sein même du camp révolutionnaire. Encore aujourd’hui, au sein d’une gauche qui se dit radicale, on parle parfois de « dysfonctionnements » de la police ou on critique les « violences policières » comme si la police pouvait ne pas faire violence aux pauvres, aux personnes issues de l’immigration et de l’histoire coloniale… Ces discours qui ne remettent pas en cause l’institution policière ou la justice, qui font comme si la cause révolutionnaire pouvait s’accommoder de ces institutions, c’est cela qui est décourageant à vrai dire.
Dans un article paru chez Lundi Matin, vous pointiez du doigt l’inefficacité et la vacuité des discours réformistes sur la police. Pourriez-vous revenir sur cette question ?
Il faut toujours se demander à qui et à quoi sert la police. Quand l’extrême gauche tombe dans le piège réformiste, c’est au mieux une forme de flemme intellectuelle, un refus de faire une analyse de classe, de genre et de race sur la question du système pénal ; au pire, une forme de collusion avec les intérêts de l’État et du capitalisme pour s’accommoder de la criminalisation de certaines populations.
Être « scandalisé·e par l’impunité », ce n’est pas la même chose que d’éprouver une « jouissance » punitive.
Gwenola Ricordeau
En 2021, en Italie, l’homme qui a déclenché l’explosion de TNT ayant tué le juge Giovanni Falcone est sorti de prison, après avoir bénéficié d’une réduction de peine grâce à une loi formulée par Falcone lui-même permettant aux repentis mafieux de voir leur peine réduite s’ils collaborent avec la justice. Cela a fait scandale. Le peuple italien réclamait son incarcération à vie et une réinstauration de la peine de mort. Pourtant, Falcone et Borsellino ont mis en évidence les insuffisances du système pénal et de la prison, et ont indiqué clairement que le problème n’est jamais « l’homme qui active la bombe » mais le système d’omerta et de violence dont il est issu. Comment alors expliquer au plus grand nombre que la jouissance que l’on peut éprouver face à la punition ne crée pas plus de justice ? Comment sortir du « populisme pénal » ?
Je me réfère toujours à un texte de Ruth Morris [autrice canadienne d’origine états-unienne, l’une des pionnières de la pensée abolitionniste dans les années 1970, ndlr] que je trouve fondamental dans la réflexion autour de la justice et de ce que l’on attend de celle-ci. Il est inclus dans mon dernier ouvrage, Crimes & Peines. Penser l’abolitionnisme pénal. Elle y développe l’idée que toutes les victimes, quelle que soit la forme de victimation, ont cinq besoins principaux : obtenir des réponses à leurs questions sur les faits ; voir leur préjudice reconnu ; être en sécurité ; pouvoir donner un sens à ce qu’elles ont subi ; obtenir réparation. Les victimes de la mafia ou d’autres types de crimes ont aussi ces besoins.
Quant à la jouissance vis-à-vis de la punition, certes il s’agit d’un sentiment assez superficiel, néanmoins il faut se demander si les torts commis ont été effectivement reconnus. Les gens sont scandalisés par l’impunité. Être « scandalisé·e par l’impunité », ce n’est pas la même chose que d’éprouver une « jouissance » punitive. Il y a peut-être davantage une recherche de reconnaissance qu’un désir de punir.
Lorsqu’on appelle à la reconnaissance d’un crime, on fait recours à la « fonction de dénonciation ». Elle consiste à dire sur la place publique que tel acte doit être dénoncé et considéré comme étant grave. On peut néanmoins imaginer que la dénonciation des préjudices puisse se faire en dehors du droit et du système pénal.
Gwenola Ricordeau
De la reconnaissance des crimes
Comme vous l’indiquez dans Pour elles toutes, le criminologue Louk Hulsman estime que le crime n’est que le produit de la société qui le crée. Que c’est la pénalisation qui a créé les crimes. Pourtant, si je pense à des mouvements féministes comme #MeToo, je vois une lutte pour que justement les violences des hommes contre les femmes soient mieux criminalisées. Sans passer par la case « criminalisation », notre société n’aurait peut-être pas entendu l’ampleur du problème. Reconnaître certaines actions comme des crimes est aussi un combat pour plus de démocratie et de justice (par exemple la reconnaissance des crimes contre l’humanité en Algérie). En réinterprétant la notion de crime, ne risque-t-on pas de dévaloriser ces luttes ?
Lorsqu’on appelle à la criminalisation ou à la reconnaissance d’un crime, on fait recours à une fonction du droit qui est la « fonction de dénonciation ». Elle consiste à dire, sur la place publique ou à la société toute entière, que tel acte doit être dénoncé et considéré comme étant grave. On peut néanmoins imaginer que la dénonciation des préjudices puisse se faire en dehors du droit ou du système pénal. L’un des problèmes qui va avec ces appels à la criminalisation ou à la création de nouvelles catégories de crimes, c’est que, comme le souligne Louk Hulsman, il existe un lien entre crime et responsabilité individuelle. Par exemple, si on pense à la mouvance qui appelle à criminaliser les torts commis à l’encontre de l’environnement, à reconnaître l’écocide, il y a au fond la volonté de criminaliser des individus… sans pour autant questionner le système capitaliste et colonial qui mène à la destruction de l’environnement. Ruth Morris explique bien que le système pénal a intérêt de détourner l’attention des véritables crimes pour porter l’attention sur des individus tenus pour responsables de certains faits. Autrement dit, en criminalisant des individus, on ne s’attaque pas au système ayant produit ces crimes. L’abolitionnisme ne se désintéresse pas des torts commis. Il dit simplement que la prise en charge par la criminalisation de certaines personnes n’est pas une bonne solution car elle ne met pas fin au système qui crée ces torts.

Est-ce que féminisme rime toujours avec abolitionnisme ? Se situer en abolitionniste n’est-il pas aussi aller à l’encontre des courants féministes dominants ?
Les courants dominants du féminisme appellent sans cesse, depuis plusieurs décennies, à davantage de recours au système pénal, à davantage de dépôts de plaintes, à davantage de criminalisation. Ce courant-là peut être caractérisé de plusieurs manières : la sociologue Elizabeth Bernstein l’appelle « féminisme carcéral » ou bien « féminisme punitif ». L’approche abolitionniste s’oppose donc à ce courant dominant en rappelant que les féministes qui ont des avantages à recourir au système pénal passent sous silence les réelles fonctions de ce système et quelles sont les populations qui en sont les cibles réelles.
Je pense qu’un mouvement révolutionnaire ne peut pas se réduire à la création d’espaces prétendument libérés de rapports de domination.
Gwenola Ricordeau
Justement, dans votre livre Pour elles toutes, vous développez l’idée que les proches des personnes incarcérées sont parmi les victimes du système pénal. Cette réflexion est, selon vous, trop peu prise en compte par les féministes et par les abolitionnistes.
En effet, il s’agit là d’une thématique qui me tient particulièrement à cœur. Je suis devenue abolitionniste de par mon expérience d’avoir eu des proches incarcéré·es et du fait d’avoir réalisé qu’il s’agissait là d’une expérience de femme. Cela m’a emmené dans des réflexions féministes que je n’avais pas avant. Les proches des personnes détenues font un travail de care et de gestion domestique, et pour l’essentiel ce sont des femmes qui soutiennent les personnes détenues, qu’iels soient incarceré·es dans des prisons pour hommes ou pour femmes.
L’autonomisation de la justice pourrait-elle correspondre à toute la société et non seulement à certaines communautés marginalisées et opprimées par le système pénal ?
Bien sûr que l’autonomie de la justice ne peut pas marcher dans une société capitaliste dont l’organisation-même ne permet pas cette autonomie, qu’on peut aussi appeler « justice transformative ». Le mode de vie capitaliste fait qu’on est obligé·e de recourir à des professionnel·les du règlement des torts, d’appeler un numéro vert et de déléguer nos conflits. Si la question est « Est-ce que demain on peut passer de la justice pénale à la justice transformative ? », la réponse est « Sans doute pas, en tout cas en l’absence d’un processus révolutionnaire ».
Une fois qu’on a dit cela, il faut préciser deux choses : d’une part, beaucoup de gens se passent de la justice pénale. Peut-être aussi car iels sont privilégié·es et ont donc les ressources pour le faire. D’autre part, d’autres individus sont obligés de s’en passer car recourir au système pénal serait un risque. Je pense aux personnes sans titre de séjour, aux TDS, aux LGBT+, aux personnes racisées, ces populations qui ont des raisons de se méfier du système pénal. Pour ces communautés, le recours à la justice transformative peut être une affaire de survie. Il est donc hors de question de dénigrer cette forme de justice pour ce qu’elle apporte à ces personnes marginalisées, à ces communautés en quête de reconnaissance et de réparations.
Mon abolitionnisme est plutôt du côté de la formation d’un mouvement révolutionnaire et non pas de la seule création d’espaces libérés – du patriarcat, du capitalisme ou d’autres rapports de domination.
Gwenola Ricordeau
Les limites de la justice transformative
Selon vous, est-il possible de créer des espaces de justice autonome ?
Je crois que la justice transformative devrait être envisagée comme une contribution à un processus plus large qui permettra l’abolition du système pénal. D’un côté, ces outils de survie doivent être soutenus et encouragés (il ne me revient pas de juger de comment les communautés envisagent leur justice et leur organisation), et d’un autre côté, je ne pense pas qu’on puisse abolir le système pénal en créant seulement des espaces d’autonomie. Toutes les zones d’autonomie sont à la fois enthousiasmantes et utiles d’un point de vue stratégique et d’expérimentation, mais elles sont aussi destinées à mourir pour laisser place à d’autres processus. Mon abolitionnisme est plutôt du côté de la formation d’un mouvement révolutionnaire et non pas de la seule création d’espaces libérés – du patriarcat, du capitalisme ou d’autres rapports de domination.
En effet, cette tension est très présente dans les communautés queers : faut-il créer des espaces alternatifs ou bien initier un mouvement global ? Telle est la question.
Ma position est celle de soutien et d’admiration de la créativité de ces espaces, de reconnaissance pour ce qu’ils permettent, individuellement et collectivement. Néanmoins, je pense qu’un mouvement révolutionnaire ne peut pas se réduire à la création d’espaces prétendument libérés de rapports de domination.
Concrètement, quels pourraient être les écueils dans la mise en place de la justice transformative ?
La principale limite de la mise en place concrète de la justice transformative me paraît être le fait que celle-ci se fait au sein d’un système qui n’est tout simplement pas fait pour la justice transformative. Les ressources sont donc limitées en termes de temps, de charge mentale : cette configuration fait que ce n’est pas n’importe qui qui peut avoir accès à ce type de justice. Il s’agit souvent d’individus qui font déjà partie d’un réseau affinitaire. Ce n’est pas un reproche, mais c’est une grande limite. Je peux aussi penser à la division du travail : ce sont le plus souvent des femmes qui s’y collent.
On peut également redouter qu’il se produise ce qui s’est passé avec la justice restaurative : qu’elle soit récupérée par une forme de professionnalisation. La professionnalisation de la justice transformative va complètement à l’encontre de son propos. Il ne faudrait surtout pas qu’il y ait des personnes qui deviennent des professionnel·les de la justice transformative : on aurait juste là une reproduction de schémas étatiques, le risque d’une forme de délégation de nos conflits et le développement d’un secteur qui pourrait être associatif, mais tirerait néanmoins profit (financièrement et symboliquement) du règlement des torts – sans compter que la professionnalisation s’accompagne souvent d’un processus normatif… bien éloigné de l’appel à la créativité et au « bricolage » au cœur de la justice transformative. Il faut aussi être vigilant aux appels grandissants à remplacer le recours à la police par celui à des travailleur·ses sociaux·les… Quand on parle d’abolition de la police, le terme « police » ne désigne pas seulement l’institution policière.
Pourtant, si certain·es se collent à la justice transformative pour apporter une aide à la communauté dont iels sont issu·es, il faut bien que leur travail soit reconnu, même si je comprends bien le problème de la légitimité à s’emparer de l’administration de la justice. Je veux dire, face à des communautés qui s’entredéchirent pour un rien, heureusement qu’on a les outils de la justice transformative à notre disposition…
Si des individus pratiquent la justice transformative en la faisant rentrer dans un système marchand, y compris sous forme associative, on change la nature de la manière dont la justice transformative a été pensée. Néanmoins, je comprends bien la contradiction que vous soulevez. Une personne queer qui consacre son temps à la résolution de conflits, au bout d’un moment, ne va pas vivre d’eau, d’amour et de l’air pollué de nos villes. Elle est évidemment légitime dans son besoin de survie. Mais on sait ce que l’institutionnalisation du féminisme a fait au féminisme. Et dire cela n’enlève rien à la sincérité de certaines militantes, aux contradictions dans lesquelles elles ont été prises. Mais justement, les contradictions se résolvent collectivement…
Au gré de récupérations réformistes, l’abolitionnisme pourrait devenir un code de conduite pour les individus qui s’accompagne de nouvelles injonctions pour les victimes : qu’on leur dise ce qu’elles doivent ressentir, ce qu’il serait bon de faire ou ne pas faire.
Gwenola Ricordeau
Des liens politiques entre justice et amour
Si la justice transformative « se fait en collectif », à quel point « penser la justice autrement » est aussi un chemin individuel de cohérence et de révision de nos acquis personnels ?
Je ne suis pas dans un abolitionnisme du développement personnel. Je crois assez peu aux injonctions individuelles à changer soi-même. Certaines tendances actuelles, surtout aux États-Unis, m’inquiètent parce que, au gré de récupérations réformistes, l’abolitionnisme pourrait devenir un code de conduite pour les individus qui s’accompagne de nouvelles injonctions pour les victimes : qu’on leur dise ce qu’elles doivent ressentir, ce qu’il serait bon de faire ou ne pas faire. L’abolitionnisme est une œuvre collective qui doit évidemment aller avec un changement de valeurs individuelles. Mais il ne s’agit pas là de créer une nouvelle manière d’être et des nouvelles règles. Je suis par exemple totalement étrangère à la question des safe spaces. Je trouve cela sacrément hypocrite de décréter que des espaces sont sécurisés. Pour qui le sont-ils ? Évidemment, en tant que militante j’ai une responsabilité individuelle à devenir un individu meilleur, une personne consciente de ses privilèges et de ses contradictions. Mais cette responsabilité individuelle ne suffit pas à générer un processus politique.
Je constate que bien plus qu’un besoin de vengeance, les victimes expriment d’abord un grand besoin d’amour. De care. Lorsqu’on a subi des faits graves, ce processus de guérison s’accompagne de formes de compréhension et on accède à la compréhension aussi de manière sensible.
Gwenola Ricordeau
Quand je lis la fameuse phrase de bell hooks « there can be no love without justice », je ne peux m’empêcher de penser qu’il y a un lien entre amour et justice. Tout en sachant que les écrits de bell hooks sont nourris de ses combats pour les droits civiques et que je ne suis qu’une alliée de ces luttes-là, je me dis que son discours sur l’amour peut devenir une source d’inspiration pour la justice transformative. Que l’amour, au sens de soin, de capacité à être guéri·e et à guérir, en tant que force fédératrice d’une communauté, peut devenir une visée pour notre justice et sur le long terme, pour sortir du système pénal. Je me dis cela aussi parce que je trouve qu’il y a un lien entre les luttes LGBTQ+ autour de la liberté d’aimer et les combats LGBTQ+ pour une justice différente. Par ailleurs, l’amour est l’un des éléments qui font la communauté : comme le développe bell hooks, l’amour est aussi ce qui nous fait appartenir à quelque chose de plus grand. Pensez-vous que ce lien entre justice et amour peut être fructueux dans notre approche de la justice transformative ? Qu’est-ce que les discours écoféministes autour du réenchantement du monde et du soin peuvent apporter à l’abolitionnisme ?
L’amour n’est pas mon point de départ dans la réflexion abolitionniste. Néanmoins, il est certain que la question de l’amour, du care, du souci de l’autre ou encore de l’« hospitalité radicale » me paraît centrale pour affirmer les valeurs de l’abolitionnisme. Cela touche à la question de savoir comment faire en sorte que les moyens de la justice transformative ne tombent pas dans les mains de nos ennemis. Il nous faut un abolitionnisme qui mette en avant un engagement anti-capitaliste, anti-patriarcal, anti-raciste, anti-colonial et anti-validiste, autrement cela deviendra un abolitionnisme libertarien. Mon abolitionnisme porte une critique de tous les systèmes d’exploitation.
En tout cas, même si je ne viens pas de cette école-là, ce que votre question m’évoque est que souvent, face à la perspective d’un tort subi, on entend des discours du type « S’il m’arrivait ça, je me vengerais ». Eh bien, je constate que bien plus qu’un besoin de vengeance, les victimes expriment d’abord un grand besoin d’amour. De care. Lorsqu’on a subi des faits graves, ce processus de guérison s’accompagne de formes de compréhension et on accède à la compréhension aussi de manière sensible. Je ne veux pas faire de grands discours sur le « pardon qui guérit ». Je pense simplement que la guérison se fait aussi par l’amour de soi et l’amour qu’on reçoit. L’idée que la guérison passe par la vengeance doit être en effet démystifiée.
Éric Dupond-Moretti se targue d’avoir obtenu une augmentation de 8% du budget de la justice pendant son mandat. Il a, entre autres, mis en place des lunettes de réalité virtuelle pour lutter contre les violences faites aux femmes qui permettraient aux agresseurs de s’identifier avec une victime… Bon, à défaut de pouvoir abolir les prisons dès 2022, si vous deviez conseiller le/la futur·e ministre de la Justice, dans quoi recommanderiez-vous d’investir cet argent, autrement que dans des super lunettes high tech ?
Je vais vous répondre très sérieusement : je pense que cet argent, le seul moyen de l’utiliser, ce serait d’acheter des tractopelles pour détruire les prisons (rires). Blague à part, pour moi, toute augmentation du budget de la justice est un échec. Je ne vois pas comment investir de manière positive l’argent de ce ministère. Je ne suis pas pour le mettre dans la formation de médiateur·ices, ni pour l’amélioration des prisons : quand on est abolitionniste, on veut abolir le système pénal, il est donc logique de s’opposer à toute forme d’expansion des moyens de celui-ci.

