Une pandémie peut-elle en cacher une autre ? Le Covid-19 risquerait bien de ricocher sur le VIH. Avec 38 millions de personnes infectées dans le monde (dont une minorité seulement sous traitement), un déficit de dépistage, d’information et d’accès aux soins, une re-mobilisation face au VIH/sida devient urgente. La Journée mondiale de lutte contre le sida, ce 1er décembre, en est l’occasion.
« Ah bon, le sida n’était pas en voie de disparition ? » Non, loin de là. Ces dernières années ont même été marquées par une démobilisation du grand public, aggravée par le Covid-19. Les objectifs de lutte contre le sida des Nations unies pour 2020 sont loin d’avoir été atteints. Un recul de 75% de nouvelles infections était visé entre 2010 et 2020. Le résultat : une baisse de 23% seulement… Pourtant, les programmes de recherche et de prévention ne disposent pas de moyens suffisants pour répondre aux enjeux.
Où en est-on du sida en 2020 ?
Pour rappel, le VIH désigne le virus qui s’attaque au système immunitaire tandis que le sida est un syndrome du VIH, c’est le stade le plus avancé de l’infection. On peut vivre des années avec le virus (et le transmettre) sans aucun symptôme. Des traitements médicaux existent désormais pour empêcher le développement du VIH en maladie de sida. Aujourd’hui, une personne séropositive au VIH, si elle bénéficie d’un traitement, peut avoir la même espérance de vie qu’une personne négative. Mais, même si le médicament empêche la transmission du virus, ce dernier reste toute la vie dans l’organisme et peut redevenir actif en cas d’arrêt du traitement. À ce jour, on ne guérit donc jamais vraiment du VIH.
Le très faible accès aux soins pour la majorité de la population mondiale fait obstacle à une victoire définitive contre le sida. L’exposition au VIH est comme un calque des discriminations mondiales : les populations les plus touchées sont les femmes africaines (en particulier quand elles ne peuvent pas refuser de rapports non protégés), les enfants (contaminé·es par leur mère), les travailleur·euses du sexe, les migrant·es (avec des contaminations de plus en plus courantes lors des parcours migratoires), les homosexuel·les, les usager·es de drogues, les détenu·es. L’accès aux soins est particulièrement difficile pour les femmes et enfants africain·es. Ce pourquoi le sida reste la première cause de mortalité des femmes de 15 à 49 ans dans le monde. De plus, moins de la moitié des enfants séropositif·ves ont accès à un traitement, entraînant la mort de 110 000 enfants l’année dernière.
Il faut aussi détromper ceux·elles malheureusement rassuré·es par l’idée que le VIH menace uniquement des pays lointains. On le sait, les épidémies limitées à une région ont cédé le pas aux pandémies mondiales, les frontières ne protègent pas des virus. La lutte contre le VIH ne peut donc être que mondiale. Par ailleurs, le VIH se plaît aussi bien dans nos espaces familiers avec 173 000 personnes séropositives en France (dont 24 000 l’ignorent) selon le CRIPS. La Guyane et Mayotte sont les départements les plus touchés.
Venue aggraver un bilan déjà peu glorieux, la pandémie de Covid-19 met en danger la lutte contre le sida et approfondit toutes les inégalités d’accès aux services de dépistage et de soins. En raison d’un recul historique du dépistage – diminution de 62% en France lors du premier confinement, selon Santé Publique France –, un nombre important d’infections n’a pas pu être détecté et les retards de soin s’accumulent. L’impact négatif du Covid-19 pourrait causer entre 70 000 et 150 000 décès supplémentaires dans les deux ans, selon un rapport d’ONUSIDA.
Journée mondiale de lutte contre le sida : l’urgence d’un ré-engagement
L’ONUSIDA appelle les pays à intensifier leur action, avec de nouveaux objectifs qui se résument par la formule 90-90-90 : que 90% des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut, que 90% de ces dernières soient sous traitement, et que parmi celles-ci, 90% aient une charge virale indétectable. La présidente de Sidaction, Françoise Barré-Sinoussi, rappelle dans un entretien pour 20 Minutes, le 27 novembre dernier, que « le VIH est encore là », et que « des jeunes, mais aussi des personnes de plus de 50 ans » s’infectent parce qu’ils « ne se protègent plus ».
Le VIH est un virus bien plus actuel qu’on ne le croit, d’autant que les obstacles à la lutte contre le sida sont parmi les enjeux majeurs du XXIe siècle : droit à des services de santé sexuelle et reproductive de qualité, droit à l’information des femmes, protection des enfants, protection des migrant·es, combats contre les discriminations et marginalisations. Le principal frein à la prévention et aux soins est en effet la répression de certaines populations minoritaires (en particulier homosexuel·les, transgenres, usager·es de drogues, migrant·es). Il faut aussi, grâce à l’information et la prévention, combattre certaines représentations de la séropositivité, car dans de nombreux pays, la connaissance de ce statut expose au bannissement social. Ces représentations s’appuient sur des lois discriminatoires (criminalisation de la transmission du VIH notamment) en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale.
Les échecs persistants face au VIH sont directement corrélés aux inégalités sociales, aux discriminations, aux politiques répressives, au sexisme et à la violence. Cela s’explique par le lien fondamental qui existe entre discrimination et exposition aux risques. Un individu discriminé tend à s’exposer davantage et à avoir des comportements à risque pour les autres. Seule une responsabilisation qui passe par l’intégration et le travail avec les communautés permet de trouver des solutions locales acceptées et suivies.
En France, l’une des priorités est l’accès aux soins des personnes migrantes. Les associations qui accompagnent les réfugié·es constatent des trajectoires migratoires de plus en plus traumatiques qui exposent les femmes à de forts risques d’infection, alors que nombre d’entre elles fuyaient déjà des violences sexuelles subies dans leur pays. Or on sait que la violence envers les femmes et les filles sont à l’origine de nombreuses transmissions du virus. L’autre priorité est de poursuivre les recherches afin de « développer des traitements qui pourraient induire une rémission, [c’est-à-dire] à l’issue desquels le virus serait contrôlé pour le reste de la vie », explique ainsi Françoise Barré-Sinoussi à 20 Minutes. Or les seules sources de financement de la recherche sont l’ANRS (Agence nationale de recherche sur le sida et les hépatites virales) et le Sidaction. Le Sidaction d’avril 2020 ayant été annulé, les dons et actions préventives connaissent cette année un fort recul. La journée du 1er décembre est d’autant plus cruciale.
Comment se mobiliser ?
Même si les traditionnelles manifestations ne pourront avoir lieu, de nombreuses actions sont prévues autour de cette Journée mondiale de lutte contre le sida. Une soirée spéciale était programmée le 30 novembre sur France 3 avec la diffusion du film 120 battements par minute de Robin Campillo, suivie d’un débat. Act-Up Paris organise un rassemblement à 12h30 devant l’Eglise Saint-Eustache à Paris ainsi qu’un événement en ligne avec le MAC VAL, Musée d’art contemporain du Val-de-Marne. Sur la page youtube du musée sera présenté et projeté United in Anger de Jim Hubbard, documentaire sur la naissance et la vie d’Act-Up New York, qui « relate les efforts d’Act-Up pour combattre la cupidité des entreprises privées, l’indifférence sociale et le désintérêt du gouvernement ».
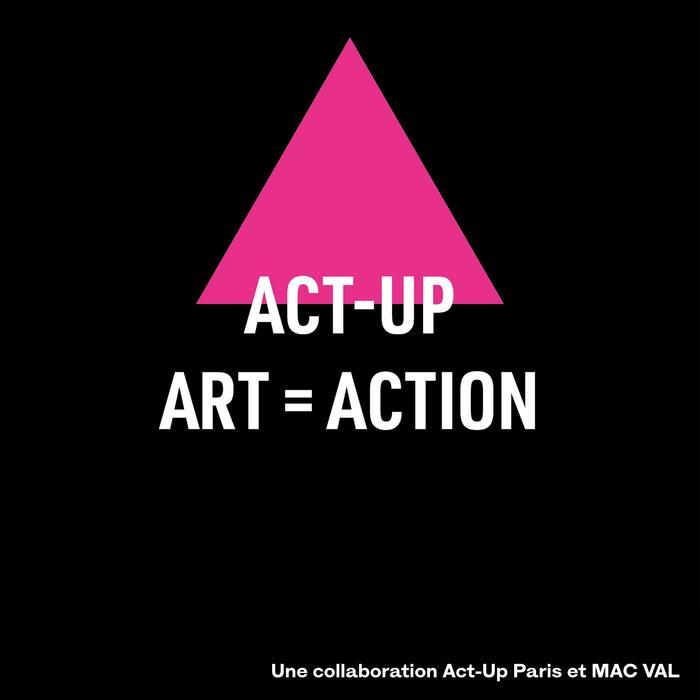
De plus, comme chaque année, l’association new-yorkaise Visual AIDS collabore avec des artistes autour du projet « Day With(out) Art » afin de sensibiliser au sida et de soutenir les artistes séropositif·ves. Le collectif What’s Your Flavor (qui programme des films expérimentaux LGBTQI+) relayera l’initiative de Visual AIDS en France et réunira Stéphane Gérard, Élisabeth Lebovici et Gaëtan Thomas autour d’une table-ronde accessible en ligne le 1er décembre à 18h30.
À l’échelle individuelle, comment s’engager contre le VIH/sida ? Trois formes d’action sont facilement accessibles : s’informer, se faire dépister et donner au Sidaction. Des campagnes de dépistage ont lieu toute la semaine et une carte accessible sur le site du Sidaction permet de repérer le Centre gratuit d’information, de dépistage et de diagnostic (CeGIDD) le plus proche pour se faire dépister gratuitement toute l’année. Il est également possible d’acheter un autotest à faire seul·e ou accompagné·e, ou de se le procurer gratuitement auprès de l’association AIDES.
Pour les personnes séronégatives les plus exposées au VIH (travailleur·euses du sexe, usager·es de drogue par voie intraveineuse et homosexuel·les ayant des rapports multiples et non protégés), le recours à la PrEP (prophylaxie pré-exposition) est également possible. Il s’agit d’un traitement préventif sous forme de médicament (TRUVADA® en France) à prise quotidienne, délivré sur prescription médicale et intégralement remboursé par la Sécurité sociale.
Enfin, il semble important de prendre aujourd’hui du recul et de partager un regard rétrospectif sur la lutte contre le VIH qui nous permet aussi d’envisager de façon nouvelle la pandémie de covid actuelle. Alors que les débats sont vifs sur l’universalité de l’accès au vaccin contre le Covid-19, le VIH est déjà ce virus inégalitaire. Pour le Covid-19 comme pour le VIH, l’enjeu ultime est de remettre le soin au cœur de nos sociétés. Depuis des décennies, la communauté mondiale accepte comme un donné inévitable la mort de millions de femmes, d’enfants et d’hommes atteint·es du sida et majoritairement africain·es. Des ressources financières extraordinaires ont pourtant été mobilisées dans la lutte contre le Covid-19.
Il ne s’agit en rien de morts inévitables mais d’un sous-investissement coupable dans la santé. La lutte contre le VIH et les autres pandémies implique une extension des politiques de santé qui devront muter en politiques intersectorielles. Une politique de santé est nécessairement sociale, économique, écologique, et intègre les questions de genre à son programme. Après des siècles d’agressions capitalistes, coloniales et patriarcales, le soin doit devenir le premier critère des politiques de reconstruction.
Image à la Une : © Chang Martin / Act-Up Paris

