En propulsant les violences sexuelles sur l’agenda médiatique, l’affaire des viols de Mazan a nuancé l’association tenace entre soumission chimique et fête. Dans La Nuit des Hommes, paru récemment chez JC Lattès, Félix Lemaître, journaliste et ancien doctorant en sociologie des drogues, nous incite également à détourner le regard des bars et des clubs pour scruter l’espace privé afin de prendre la mesure du phénomène.
Au fil d’une enquête menée de cabinets de psychologues à des archives de journaux, des tréfonds du dark web à propres souvenirs, il détricote les stéréotypes sur le GHB comme « drogue du viol » par excellence ou sur la supposée marginalité des agresseurs afin de remonter aux origines du mal : la socialisation masculine et les rapports de pouvoir entre les genres, nous invitant ainsi à un travail collectif pour les repenser. On l’a rencontré pour parler du traitement médiatique sensationnaliste des affaires de soumission chimique, de la culture du secret poussant à détourner les yeux et mettre sous le tapis des agressions, de la complaisance d’objets culturels banalisant la prédation, de défaillances des institutions ou encore de la relation toxique entre masculinité et alcool.
Manifesto XXI – Peux-tu revenir sur le contexte dans lequel tu as démarré ton enquête ?
Félix Lemaître : Alors que je couvrais des festivals en tant que journaliste musical, le bruit a commencé à courir selon lequel des « piqueurs » injecteraient du GHB à des personnes avec des seringues pour les agresser. En toile de fond, il y avait le mouvement #balancetonbar. Alors que je suis assez « protégé » en tant qu’homme [cisgenre hétérosexuel], je commence à porter un autre regard sur la fête. Je me rends compte que l’insouciance est un privilège [masculin] la nuit. Mais rapidement le traitement des médias m’a interrogé et ça a en quelque sorte réveillé le sociologue des drogues refoulé en moi. Alors qu’on ne savait pas encore ce qu’il y avait dans les seringues ni ce qui se tramait exactement, certains titraient déjà : « les piqûres de GHB, ce fléau. » Quand tu regardes ça avec l’œil des sciences sociales, c’est un peu n’importe quoi !
Si tu commences ton enquête en allant regarder du côté de l’espace festif, tu te rends rapidement compte que le phénomène auquel tu pensais te confronter dépasse largement ce cadre. C’est quoi, la réalité de la soumission chimique ?
Selon un rapport de l’Agence du Médicament, les faits de soumission chimique auraient lieu dans 42% des cas dans un contexte privé, c’est-à-dire chez les victimes, et ces actes sont perpétrés par des auteurs souvent connus d’elles (41,5%). L’administration de la substance à l’insu de la victime ou sous la menace peut advenir aussi bien dans des fêtes privées que dans un contexte familial, rejoignant des enjeux de violences conjugales ou d’inceste (des parents ou proches qui droguent le jus d’orange des enfants…). En faisant des recherches sur le dark web, j’ai ainsi découvert l’existence de « tutos viol », avec une partie « soumission chimique » où les auteurs conseillaient aux lecteurs de droguer leurs victimes chez elles car elles seraient plus en confiance, ce qui faciliterait l’administration de la substance. Elles seraient aussi moins paniquées en se levant et donc moins à même de comprendre ce qu’il leur est arrivé. Je ne sais pas à quel point ces guides sont vraiment consultés, mais le simple fait qu’ils existent en dit long sur la culture du viol.
On a bien détecté des traces de piqûres, mais qui auraient vraisemblablement plutôt été causées par de simples aiguilles. Cela pousse à penser qu’on pourrait être face à des violences volontaires à caractère réactionnaire, visant à faire peur aux femmes dans l’espace public.
Tu t’attaques aussi à la désignation du GHB comme « drogue du viol » ou « drogue du violeur ». Qu’est-ce qui te dérange dans ces formules médiatiques rebattues ?
Ce qui me gêne, c’est qu’elles détournent en quelque sorte l’attention sur la drogue plutôt que sur le violeur : on dirait presque que c’est le produit le coupable, et qu’il est destiné à cette fin. Alors que le GHB a eu plusieurs vies et usages : on l’a tour à tour utilisé comme anesthésiant (on a même donné à des femmes enceintes dans les années 60), traitement contre la narcolepsie, drogue récréative… Dans les années 80, il était utilisé par les bodybuilders pour les aider à dormir malgré les shoots d’anabolisant. Bref, ce n’est pas par essence la drogue du viol, d’ailleurs elle est très peu utilisée dans la soumission chimique ! Toujours selon le même rapport de l’Agence du Médicament, ce sont les médicaments qui sont utilisés en premier pour la soumission chimique. Ce sont des substances légales donc, qu’on peut trouver dans toutes les armoires à pharmacie. En deuxième c’est la MDMA, en troisième l’alcool, et le GHB est en bas de la liste (seulement 9% des cas). Pourtant, en se concentrant sur le GHB, on s’inscrit dans une tradition de lutte contre la drogue qui appelle une réponse sécuritaire style : « on va arrêter les dealers et ainsi il n’y aura plus de viols ! » C’est bien commode…
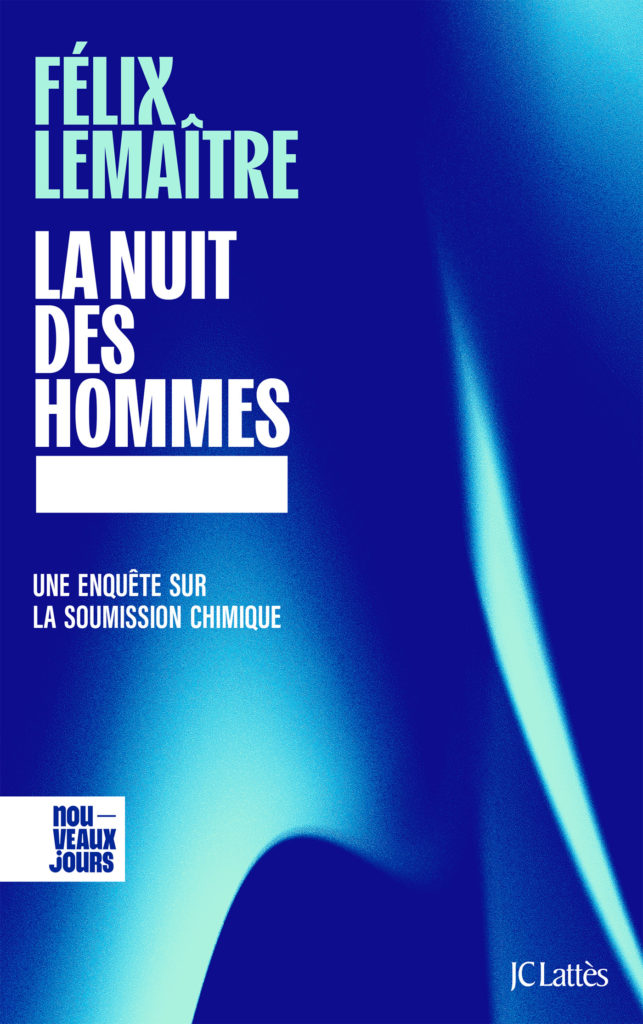
Et les « piqûres sauvages » dans tout ça, mythe ou réalité ?
Il y a eu 2 000 plaintes, mais aucun cas avec des substances prouvées. En revanche, on a bien détecté des traces de piqûres, mais qui auraient vraisemblablement plutôt été causées par de simples aiguilles. Cela pousse à penser qu’on pourrait être face à des violences volontaires à caractère réactionnaire, visant à faire peur aux femmes dans l’espace public. Il y a aussi sans doute une part de psychose collective, catalysée par les réseaux sociaux. Le contexte était particulier : on sortait tout juste du Covid, on ne savait plus vraiment comment être ensemble. Il est par ailleurs curieux de voir que le terme « piqûre sauvage » s’est imposé dans les médias, à un moment où on parlait « d’ensauvagement de la société ». « Sauvage » est un terme connoté, il est très utilisé par la fachosphère, qui a commencé à cette époque à faire courir la rumeur selon laquelle les auteurs seraient des personnes en situation irrégulière. Cela a eu des effets concrets : Mediapart a ainsi relaté une affaire où deux personnes racisées se sont faites tabasser lors d’une fête de village dans l’Aude car on les a accusées à tort de piquer.
En faisant tes recherches pour le livre, quels autres tropismes journalistiques as-tu pu observer dans le traitement des affaires de soumission chimique ?
Déjà, la soumission chimique n’est pas toujours traitée comme un élément de l’affaire. De la même manière qu’on a maquillé les violences conjugales en « crimes passionnels », le lexique de la séduction va s’immiscer dans l’agression avec des formules comme « fantasmes mortels »… J’ai même vu « le séducteur martiniquais » pour désigner un agresseur dénommé Sylvestre Beuze, dans un triste combo de sexisme et de clichés racistes. Il y a une tendance générale au sensationnalisme avec une fascination pour les violeurs en série et leur sombre « tableau de chasse » : le nombre de victimes ou le temps du supplice (« abusée pendant des années » ou « de longues heures »…). Les agresseurs sont parfois présentés comme des sortes de personnages avec des surnoms comme « le violeur à la trottinette », donnant aux affaires des allures étranges ou hors norme.
Quand on regarde de plus près, des réalités plus banales apparaissent bien souvent. Cet homme a violé 100 femmes, c’est certes énorme. Mais peut-être s’agissait-il en outre d’une personne en apparence ordinaire et socialement insérée, qui a pu agir impunément pendant des années car la police n’a pas cru des victimes, par exemple. Ce sont ces questions que les médias devraient mettre en avant plutôt que des détails inutilement morbides.
Une des images médiatiques répandues dans les violences sexuelles que tu t’attaches à déconstruire, c’est celle du « monstre »…
Les féministes le disent depuis des années : il n’y pas de « monstre », cette figure invisibilise la banalité du mal. Dans l’affaire Pelicot, on nous ressort cet épouvantail du monstre animé par des tendances « perverses » voire « nécrophiles »… Or la « perversion » (la tendance à jouir de la manipulation d’autrui) est un concept aux concepts flous et variables : des historiens ont ainsi montré qu’on avait classé les homosexuels comme des pervers à certaines époques ! Quant à la nécrophilie, cela peut être une clef pour tenter d’appréhender le désir du corps inanimé mais c’est très marginal. J’ai du mal à croire qu’on soit ici face à 50 nécrophiles qui se sont connectés entre eux… A mon humble avis, ces lectures sont plutôt contre-productives car elles ont tendance à recréer du monstre – le nécrophile représentant le croquemitaine ultime, le tabou des tabous –, là où les facteurs culturels me semblent primordiaux. Oui, les actes sont monstrueux mais justement, ce qui est intéressant dans ce procès, c’est de voir que les accusés sont des hommes socialement insérés, qui travaillent, pour certains dans le care (pompiers, infirmiers, gardiens de prison…). Ils violent juste parce qu’ils en ont l’occasion et ils en profitent.
La représentation sociale stéréotypée du violeur, c’est un individu issu de la classe populaire, historiquement perçue comme la classe dangereuse ou dégénérée.
Au fil de ton enquête, as-tu pu dresser un profil type des agresseurs ?
On aimerait imaginer un Emile Louis derrière le masque de l’agresseur et que ces affaires restent dans les colonnes des « faits divers » pour repousser le mal à la marge. Mais ce n’est ni des détraqués, ni des marginaux, ni des étrangers quoi qu’en dise la fachosphère ! La représentation sociale stéréotypée du violeur, c’est un individu issu de la classe populaire, historiquement perçue comme la classe dangereuse ou dégénérée. Mais des affaires récentes contribuent à faire tomber ce mythe comme celles de la députée Sandrine Josso, droguée par un parlementaire [le député Horizon Joël Guerriau ndlr], ou du rappeur P. Diddy, qui a mis la soumission chimique au profit d’un trafic sexuel de grande ampleur. C’est un phénomène parfaitement transclasse. Le seul dénominateur commun, c’est qu’il s’agit d’hommes, en écrasante majorité. C’est pour cela que l’étape d’après consiste logiquement à interroger la masculinité.
La culture du secret représente à mon sens un immense pan du problème : cette forme de lâcheté ordinaire consistant à détourner les yeux, ne pas vouloir voir ni dénoncer.
Tu écris, « j’ai commencé cette enquête comme une traque de déséquilibrés, elle est devenue une course-poursuite intérieure après mes souvenirs, pour comprendre pourquoi environ 70% des actes de soumissions chimiques (…) sont le fait d’hommes sur des femmes. » C’était important pour toi de t’exprimer à la première personne, de façon située en tant qu’homme cis et hétérosexuel ?
Au début, je n’étais à vrai dire pas certain de vouloir parler en mon nom alors qu’il y a des victimes. Mais au fur et à mesure, des souvenirs occultés remontaient à la surface, sur lesquels je portais alors un nouveau regard : des images de films problématiques regardés entre adolescents, des comportements douteux en soirée… Cette investigation m’a aidé à prendre conscience de mes privilèges et à déconstruire ma propre socialisation masculine. Il y a un côté auto-analyse en tant qu’homme dans une société patriarcale, de la même manière qu’Adorno disait qu’il s’auto-analysait comme bourgeois dans la lutte des classes. Plutôt qu’une forme totalement abstraite, je trouvais plus parlant de partir de ces exemples concrets, de ces vécus communs trop souvent mis sous le tapis car c’est des choses dont on ne parle pas (le rapport à la sexualité, à la fête…), et ça fait justement partie du problème.
A propos de cette masculinité en question, ton livre pointe du doigt des réseaux de solidarité entre hommes plus ou moins actifs. Les agresseurs agissent-ils seuls ?
Il y parfois des formes de connivence masculine très assumées, comme dans l’affaire des viols de Mazan où Pelicot a formé une sorte de disciple, mais aussi des choses plus souterraines. La culture du secret représente à mon sens un immense pan du problème : cette forme de lâcheté ordinaire consistant à détourner les yeux, ne pas vouloir voir ni dénoncer. Trois hommes sur dix contactés par Pelicot refusaient sa proposition quand ils comprenaient la teneur du rendez-vous, mais aucun d’entre eux n’est allé voir la police ! On observe aussi des transmissions liées à la socialisation masculine comme les techniques dites « de drague » qui se diffusent. Lors de l’enquête, je me suis ainsi souvenu d’une soirée de fac où un type vantait la méthode de la « voiture balais » consistant à repérer les filles les plus ivres de la soirée… Une sociologue spécialisée dans les questions du genre et de l’alcool m’a ensuite dit que certains hommes appelaient aussi cela « faire l’éboueur » et qu’ils ne considéraient pas forcément qu’il s’agit d’une agression, alors qu’il s’agit déjà d’exploiter la vulnérabilité chimique d’autrui.

Tu te penches longuement sur ce concept de vulnérabilité chimique, consistant non pas à administrer une substance à quelqu’un·e mais à profiter de l’état d’une personne qui a ingéré quelque chose d’elle-même. En quoi est-ce primordial ?
Je pense que c’est le débat d’après car c’est moteur d’un immense nombre d’agressions, mais ça ne va pas être évident à adresser car dans ces cas-là, l’alcool arrive largement en tête. Et l’alcool, c’est un peu sacré dans notre société ! Quand on y touche, on passe pour un rabat-joie, mais il y a clairement des pratiques à changer, et un lien entre alcool et masculinité à questionner. Boire est perçu comme une preuve de virilité : savoir boire, mais néanmoins boire beaucoup. C’est aussi utilisé comme un produit dopant pour séduire. Il y a quelque chose de presque néolibéral dans la pression mise sur la sexualité masculine : il faudrait « faire du chiffre », coucher le plus possible et être « rentable » quand tu sors. Quand tu écoutes les discours des « coachs en séduction », on dirait des consultants en entreprise ! L’alcool est utilisé comme un moyen de dépasser ses inhibitions et essayer d’être « performant » pour assumer son rôle, entraînant ainsi des comportements à risques. Là où on voit le poids du patriarcat, c’est qu’ivres, les hommes ont plus de chances d’agresser alors que les femmes ont plus de chance d’être agressées. L’alcool révèle et exacerbe l’asymétrie dans les rapports de pouvoir entre les genres.
Je pense que la question de la représentation se pose dans le porno de la même manière que dans le cinéma, d’autant que ces images comblent le vide laissé par le manque d’éducation sexuelle.
Tu montres que la prédation chimique est très ancrée dans nos représentations. Comment la pop culture contribue-t-elle à la minimiser et à la banaliser ?
Ma génération a grandi avec des teen sex comédies façon American Pie, vantant une culture misogyne de la fête dans laquelle il faut faire boire les filles pour espérer coucher avec elles. Dans les premiers films du genre comme Animal House, profiter d’une fille ivre lors d’une soirée estudiantine est utilisé comme un ressort comique… Cela fait écho aux affaires de soumission chimique à grande échelle sur des campus américains, avec des gobelets drogués marqués pour être distribués aux victimes. On peut en quelque sorte dire que les Fraternités fabriquent des agresseurs, en favorisant le secret et une certaine idée de l’organisation dite « fraternelle »… Plus récemment, il y a Very Bad Trip, où la situation est totalement inversée puisque ce sont des hommes qui y sont victimes de soumission chimique mais c’est encore une fois tourné à la comédie. On pourrait aussi parler de la figure de la groupie dans l’industrie musicale, dissimulant des affaires de soumission chimique et de pédocriminalité.
Tu t’attaques aussi à la question de la représentation dans le porno. Là aussi, faut-il réformer nos imaginaires ?
Lors des mes recherches, j’ai eu la mauvaise surprise de découvrir l’existence de sites recensant des scènes de viols dans des pornos et des films. Ailleurs, la soumission chimique est parfois suggérée : une personne paraît inconsciente sans que l’on sache pourquoi, on aperçoit parfois une boîte de médicaments ou une bouteille dans un coin… C’est d’autant plus troublant qu’il y a eu des affaires de prédation chimique de l’autre côté de la caméra, liées à des conditions de travail à risques dans une partie de l’industrie, entraînant une précarité psychologique et financière des performer·euses, et parfois des problèmes d’addiction corollaires.
Je pense que la question de la représentation se pose dans le porno de la même manière que dans le cinéma, d’autant que ces images comblent le vide laissé par le manque d’éducation sexuelle. On pense souvent que le sexe est une affaire d’instinct et pas de culture. Or, la sociologie a démontré qu’il existe des scripts sexuels : des représentations qui s’invitent dans nos rapports, ce qu’on s’autorise à faire et comment. Ce n’est pas une bulle hors de la société ni une boîte noire qu’on ne pourrait ouvrir sans inhiber le désir : on peut entrer dans ses arcanes pour construire quelque chose de meilleur. Il existe un porno éthique et qui propose d’autres imaginaires que celui de la domination ordinaire, mais il est encore trop peu consommé.
[Avec la correctionnalisation] de nombreux agresseurs rentrent chez eux avec un simple suivi sociojudiciaire. Cela va peut-être bientôt changer avec l’instauration de cours criminelles départementales, mais il y a là une fabrique de l’impunité qui a permis à certains de récidiver durant des années.
Parler de soumission chimique, c’est aussi parler de défaillances des institutions. Quel traitement judiciaire pour ces affaires ?
Les obstacles sont déjà vertigineux pour aller jusqu’à la justice. Les victimes ayant la mémoire altérée, elles ont parfois du mal à recomposer le puzzle. Si elles ont aussi elles-mêmes bu ou consommé des drogues, elles peuvent avoir intériorisé une morale qui leur fait se sentir coupables. Dans le cas où elles arrivent jusqu’à un commissariat, il faut que les policier⸱ières, qui ne sont pas formé⸱es sur la question, prennent correctement leur plainte et leur commandent les bons tests. Et quand bien même elles arrivent à prouver l’agression, elles sont souvent confrontées au phénomène de la correctionnalisation des peines. Comme les tribunaux sont engorgés, on leur propose de requalifier le crime qu’elles ont subi en délit afin de les rediriger vers des tribunaux correctionnels. L’idée est que le jugement soit plus rapide et donc qu’elles souffrent moins de la procédure, mais cela minimise les faits et divise les peines par deux. Résultat : de nombreux agresseurs rentrent chez eux avec un simple suivi sociojudiciaire. Cela va peut-être bientôt changer avec l’instauration de cours criminelles départementales, mais il y a là une fabrique de l’impunité qui a permis à certains de récidiver durant des années.
Penses-tu que le procès des viols de Mazan permette une forme de prise de conscience collective sur la réalité du phénomène de la soumission chimique ?
En levant le huis-clos, Gisèle Pelicot a eu un immense courage, permettant ainsi de mettre le sujet sur l’agenda médiatique et de laisser la place à la réflexion. Cependant, j’ai l’impression que beaucoup d’hommes cis ne se sentent toujours pas concernés. La réaction reste encore trop souvent « not all men, pas tous les hommes, pas moi ». Et je ne sais pas si cela va s’améliorer : un journaliste du Financial Times a ainsi montré que l’écart se creusait entre les jeunes femmes, de plus en plus progressistes, et les jeunes hommes, de plus en plus réactionnaires. Je crains donc qu’on aille vers un fossé entre les genres plutôt qu’une grande réconciliation et un meilleur vivre ensemble.
La Nuit des hommes. Une enquête sur la soumission chimique, JC Lattès, 240 p.
Interview : Bettina Forderer
Relecture et édition : Apolline Bazin

