Ex-salariée du CAC 40, Sandrine Holin analyse l’engouement des grandes entreprises pour les questions d’égalité des genres dans son premier essai Chères collaboratrices.
À quoi ressemble le féminisme reconfiguré par le néolibéralisme ? Si l’on devait tirer le portrait de cette idéologie, nous pourrions imaginer la vie d’une girlboss hyper perfectionniste qui, depuis son salon en rotin, développe son auto-entreprise tout en s’occupant des enfants. Ce discours individualiste est particulièrement fort chez les cadres supérieures qui sont parvenues à briser la première glace du plafond de verre. Sheryl Sandberg (ancienne directrice des opérations de Facebook), Christine Lagarde (ancienne directrice du FMI) ou encore Ivanka Trump (cadre supérieure de la Trump Organization) sont tant d’exemples sur lequel le féminisme néolibéral s’appuie et que Sandrine Holin décortique dans son essai intitulé Chères collaboratrices. D’abord sensibilisée aux enjeux climatiques, elle intègre les luttes féministes en s’intéressant aux questions LGBTQIA+. Deux lectures vont enclencher son processus d’écriture : King-Kong Théorie de Virginie Despentes et Naissance de la biopolitique de Michel Foucault. Convoquant de multiples références, l’ouvrage dissèque le discours féministe néolibéral, afin d’en mesurer l’influence sur les individu·e·s. Nous avons rencontré l’autrice.
Manifesto XXI – Sur quels critères la rationalité néolibérale hiérarchise-t-elle les femmes ?
Sandrine Holin : Pour répondre à cette question, je pense qu’il faut revenir sur deux points clés. Premièrement, la rationalité néolibérale considère que notre force de travail peut être assimilée à du capital humain. Les compétences que nous acquérons, par exemple, sont une manière d’augmenter son capital sur le marché. Deuxièmement, il faut aussi avoir en tête que, pour le néolibéralisme, les individu·e·s deviennent des entrepreneur·e·s d’eux-mêmes. Ce qui va hiérarchiser les femmes entre elles – et même les femmes par rapport aux hommes puisque cette rationalité a tendance à effacer la question de genre –, c’est leur valeur actuelle ou potentielle pour l’économie. Or, on sait très bien que certaines personnes naissent avec un capital, économique mais aussi social ou culturel, plus élevé. Elles ont alors des opportunités plus vastes parce qu’elles restent dans telle famille et vont avoir la possibilité d’aller dans telle école.
Donc les femmes qui se trouvent en haut de la pyramide sont des femmes blanches, bourgeoises, cisgenres, etc.
Oui, essentiellement. Cependant, notre société essaie d’entretenir le mythe de la méritocratie. Quelques exceptions montrent qu’effectivement, il y a une possibilité d’ascension sociale. Sauf que lorsque l’on étudie le parcours des transclasses, on voit que c’est extrêmement difficile de sortir des inégalités. Par ailleurs, la rationalité néolibérale s’inscrit dans un système capitaliste fondé sur un régime extractiviste. Ce système vient également d’un régime colonial (qui à certains égards l’est encore) et se trouve toujours dans un régime patriarcal. Il s’appuie donc très fortement sur les hiérarchies de classes sociales, de races et autres. Et il s’en sert pour parvenir à l’accumulation du capital.
Ce qui est dommage, je crois, c’est qu’on ne veut pas reconnaître les interdépendances que l’on a les un·e·s avec les autres. En écrivant ce livre, je voulais justement dénoncer cette fable du mérite, cette idée que nous y arrivons seul·e.
Sandrine Holin
D’ailleurs, vous expliquez que c’est cette société extractiviste qui pousse certaines femmes à en exploiter d’autres pour s’émanciper.
L’idée centrale du livre revient à dire que le féminisme néolibéral perçoit l’égalité de genre comme libre concurrence entre hommes et femmes. Dans ce système, nous n’avons que la possibilité d’être en concurrence les un·e·s avec les autres. C’est une logique compétitive dans laquelle « tu m’exploites ou je t’exploite » [titre du chapitre 7 du livre, ndlr]. Il faut bien voir que les femmes cadres supérieures touchent un salaire très élevé sont déjà en haut de la pyramide. Et elles exploitent des personnes qui sont en bas. Je ne dis pas que tout leur tombe du ciel mais elles sont obligées de collaborer avec le système si elles souhaitent s’émanciper.
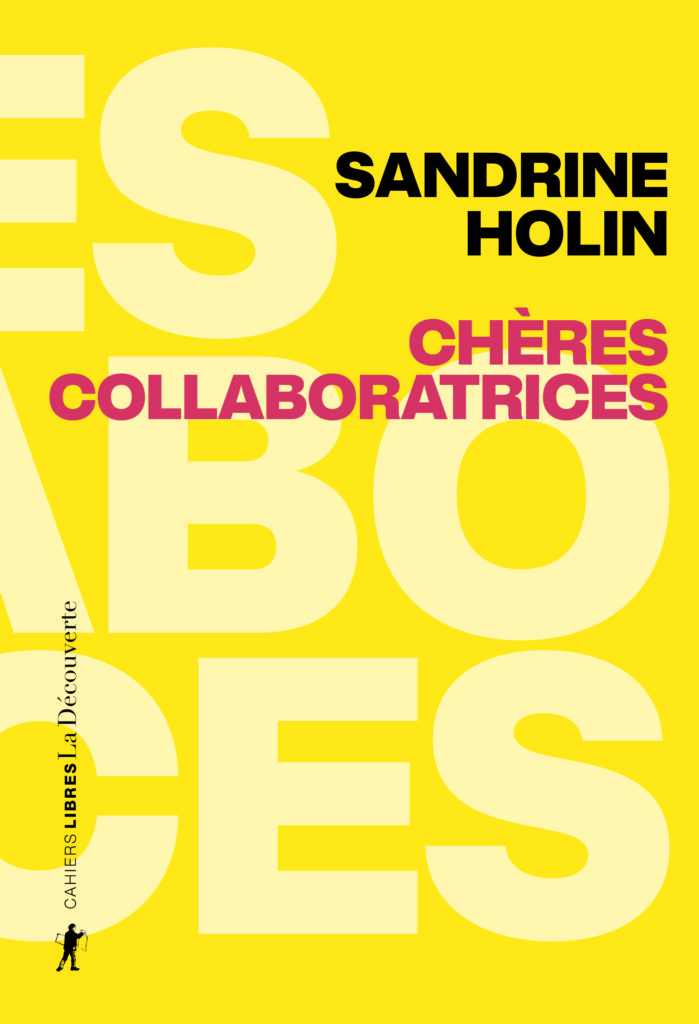
Pourtant, cet ordre ne peut tenir qu’à la condition que les métiers du care soient pris en charge par d’autres personnes, le plus souvent des femmes, racisées, issues de classes populaires, parfois migrantes…
Oui, les personnes payées pour garder les enfants, faire le ménage ou fournir d’autres services libèrent du temps à leurs employeur·se·s. Ces dernier·e·s peuvent alors se consacrer pleinement à un travail censé les émanciper. Simplement, ces métiers du care n’ont pas de grande valeur pour l’économie puisqu’ils ne permettent pas aux actionnaires de générer beaucoup d’argent. Aujourd’hui, le système capitaliste néolibéral essaie de faire en sorte qu’ils rapportent en les rationalisant. On dit alors aux infirmier·e·s : « Essayez d’être performant·e·s, de voir plus de patient·e·s par heure ». C’est vraiment très extractiviste dans le sens où on va extraire au maximum l’énergie de ces personnes pour que cela crée plus d’argent, tout en ne les payant pas plus. Ce qui est dommage, je crois, c’est qu’on ne veut pas reconnaître les interdépendances que l’on a les un·e·s avec les autres. En écrivant ce livre, je voulais justement dénoncer cette fable du mérite, cette idée que nous y arrivons seul·e.
Il ne faut pas rester coincé dans la problématique des inégalités de genre mais plutôt essayer de visualiser toutes les problématiques ensemble notamment celle du changement climatique qui est urgente et criante.
Sandrine Holin
Vous écrivez également que cette rationalité rend les individu·e·s responsables des inégalités systémiques en leur disant qu’il suffirait de « changer les mentalités » pour que la société aille mieux. Faut-il se demander si le coaching va remplacer le militantisme, voire les syndicats ?
En fait, le coach est à mi-chemin entre le psy et l’entraîneur de sport. Iel est payé·e pour vous aider à atteindre des objectifs que vous vous êtes fixé·e. Sauf que, généralement, vous le·la consultez sur une très courte durée (contrairement à un psy). Cela répond à une volonté d’avoir une solution rapide et efficace face à un problème qu’on ne traite pas vraiment à la racine. Le problème, c’est que nous vivons dans une société de la rapidité où l’on veut tout avoir tout de suite.
Vous parlez du terme « joint-venture » [faire coentreprise avec son/sa conjoint·e, ndlr] pour expliquer la manière dont les femmes choisissent leur partenaire de vie. De quelle manière le néolibéralisme reconfigure-t-il l’amour queer ou hétéro ?
Dans cette vision néolibérale de la vie, toutes les décisions sont calculées. Nous apprenons très vite à penser les coûts et les bénéfices des choses. Chaque décision est vue comme un investissement, or l’amour n’y échappe pas. D’ailleurs, dans le livre, je ne parle pas forcément d’amour mais plutôt de « mise en couple ». Quand on se met en couple avec quelqu’un·e, il y a tout un tas de « pour » et de « contre » que l’on pèse. La décision ne se base pas que sur les sentiments. Ce qui est intéressant, c’est de voir que nous revenons vers une pratique assez ancienne. Cela reste très récent de vouloir se mettre en couple avec quelqu’un·e parce que l’on est amoureux·se. Au cours de l’histoire, nous avons plus souvent été dans des configurations de couples et de familles qui prenaient la forme de partenariats.
Aujourd’hui, nous retrouvons cette idée d’intéressement à se mettre en couple avec telle personne. Cependant, il faut toujours donner l’impression de prendre cette décision uniquement sur la base des sentiments sinon ça ne passerait pas du tout socialement. Je pense qu’il y a effectivement des sentiments en jeux, mais à côté de cela se greffent des questions économiques. Dès lors, est-ce que quelqu’un·.e qui tomberait amoureux·se d’une personne économiquement désavantagée se mettrait en couple avec ? C’est la question qu’il faut se poser.
Donc la rationalité néolibérale encourage l’endogamie.
Exactement. Nous pourrions aussi tout à fait imaginer qu’une femme qui appartient à un milieu culturellement libertaire et qui souhaite faire carrière soit très contente d’être avec un homme père au foyer. Toutes les configurations sont possibles. En fait, ce n’est pas quelque chose de conscient mais en analysant certains discours et certaines pratiques, nous nous rendons compte que derrière les relations, il y a toute une logique de « est-ce que c’est stratégiquement intéressant de se mettre en couple avec cette personne ». Par ailleurs, la rationalité néolibérale encourage toujours le modèle du couple monogame avec des enfants car cela serait la configuration la plus stable économiquement.
D’où la politique du zéro compromis qui incite les femmes à mener de front leur carrière ainsi que leur vie de famille. Justement, quelle retraite et quelle vieillesse attendent ces femmes à qui on a dit qu’il fallait tout avoir ?
Cette question me fait penser au discours mobilisé par les plateformes de finance féministes qui incitent les femmes à investir leur épargne en bourse. Parmi leurs arguments, il y a ce constat qu’à la retraite, l’écart de richesse entre les genres est immense. Cela serait dû aux inégalités de revenus mais aussi au fait que les femmes investissent moins. Pour compenser cet écart, il faudrait placer son épargne dès maintenant afin de percevoir une retraite décente. Ce que vous disent ces plateformes, c’est qu’il vaut mieux choisir une solution pour vous-même plutôt que d’attendre que la société vous aide à bien vieillir. C’est une solution problématique et très individualiste.
Il y a plein de féminismes qui se trouvent en dehors de cette rationalité. On peut avoir l’impression que ce sont des utopies mais c’est bien, aussi, de créer des utopies !
Sandrine Holin
Là, nous parlons en termes financiers. Mais en matière d’agentivité, comment vont-elles gérer la perte de pouvoir lorsqu’elles ne travailleront plus ?
Celles qui sont tout en haut de la pyramide ne s’arrêtent pas de travailler. Je pense à Christine Lagarde ou Sheryl Sandberg par exemple. En fait, ces femmes sont dans des milieux de pouvoir et d’influence qui doivent les captiver. Il n’y a donc aucune raison pour qu’elles s’arrêtent. Elles peuvent peut-être réduire le rythme. Certaines le feront sans doute mais la plupart aura l’occasion de bien vieillir quitte à se lancer dans une nouvelle carrière. Je les vois bien écrire des livres, donner des conseils aux jeunes femmes et continuer à entretenir leur fondation. Le pouvoir et l’intérêt médiatique portés sur elles doivent être grisants donc si cela s’arrête, leur monde s’arrête. Je pense qu’il doit y avoir une certaine accoutumance au pouvoir…
Au début de votre essai, vous vous demandez si un féminisme banal peut être révolutionnaire. Est-il possible de penser un ou des féminismes populaires qui ne soient pas dictés par la rationalité néolibérale ?
L’une des premières choses serait de bien comprendre le fonctionnement du régime néolibéral et la façon dont il nous transforme de l’intérieur. Ce serait une manière de voir ce vers quoi nous ne voulons pas aller. L’autre point important, c’est de bien penser les systèmes. Il ne faut pas rester coincé dans la problématique des inégalités de genre mais plutôt essayer de visualiser toutes les problématiques ensemble notamment celle du changement climatique qui est urgente et criante. En arrivant à penser tout cela ensemble, nous pouvons visualiser les actions vers lesquelles tendre. Après, il y a plein de féminismes qui se trouvent en dehors de cette rationalité. On peut avoir l’impression que ce sont des utopies mais c’est bien, aussi, de créer des utopies !
J’ai été assez surprise de voir la place que prenaient les cabinets de conseil dans la construction du discours féministe néolibéral. Vous mettez en avant les chiffres qu’ils renseignent sur ce que rapporterait la concurrence pure et parfaite entre les genres. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la production et l’interprétation de ces chiffres ?
Les cabinets de conseil tels que McKinsey aiguillent toutes les grandes et moyennes entreprises dans le monde. Leur recours est très fréquent, on l’a vu avec l’État français. Cela s’explique par la logique de rationalisation des coûts en entreprises qui entraîne une réduction de la masse salariale. Les entreprises consultent ces cabinets pour des besoins précis car elles ne disposent plus des ressources en interne. Les cabinets de conseil sont aussi sollicités car nous pensons que, puisqu’ils sont extérieurs, ils seraient davantage neutres. Ils sont consultés sur quasiment toutes les décisions économiques des entreprises.
Cependant, aujourd’hui, ils se positionnent également sur toutes les problématiques sociales : je parle des inégalités de genre mais ils croisent les questions de races, d’orientations sexuelles, de handicaps, etc. Leurs chiffres montrent, par exemple, qu’une femme racisée, lesbienne, qui vit avec un handicap a peu de chance d’accéder aux plus hauts postes. Derrière, ils tirent la conclusion qu’il faudrait mieux intégrer les personnes minorisées car cela serait bénéfique pour les performances d’entreprises. Je trouve cela assez problématique parce que si l’on s’aperçoit que ces politiques d’inclusion ne rapportent rien alors il y a un risque de retour en arrière.
Chères collaboratrices, de Sandrine Holin, éditions La Découverte, 240 p.
Image à la Une : © Noé Adaam
Édition et relecture : Benjamin Delaveau, Sarah Diep et Apolline Bazin

